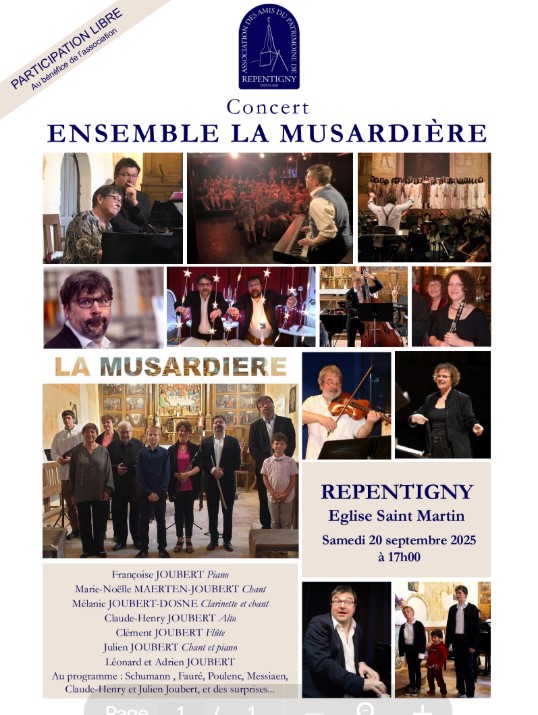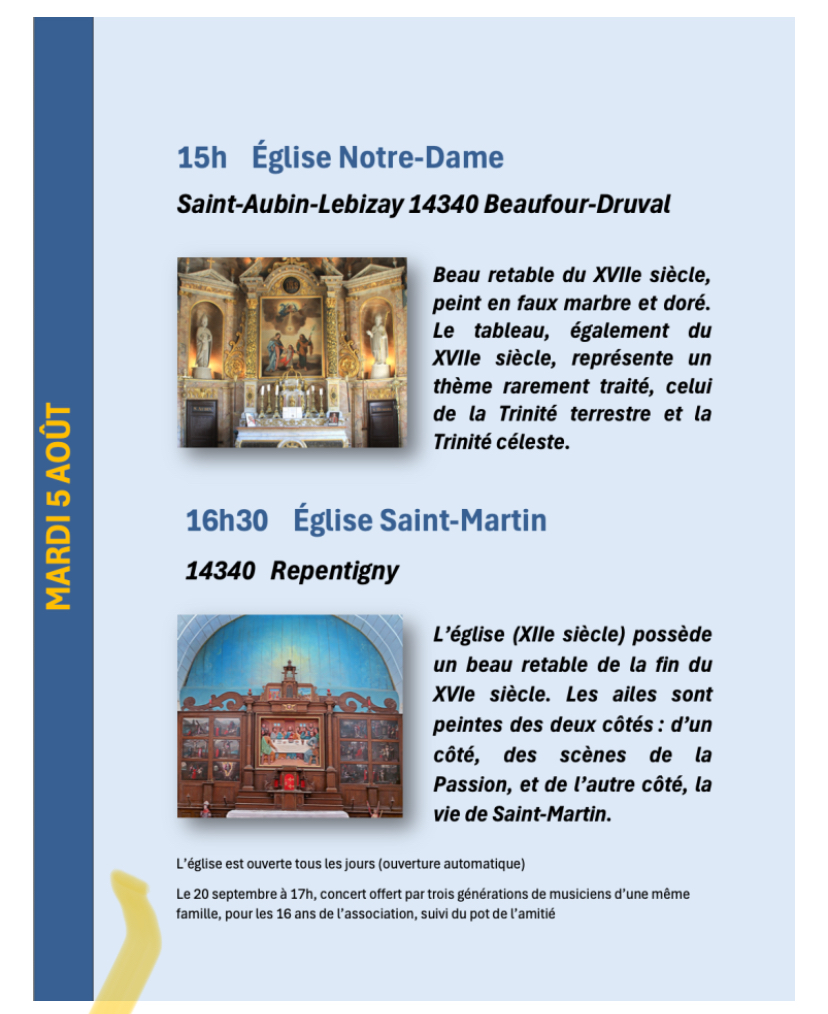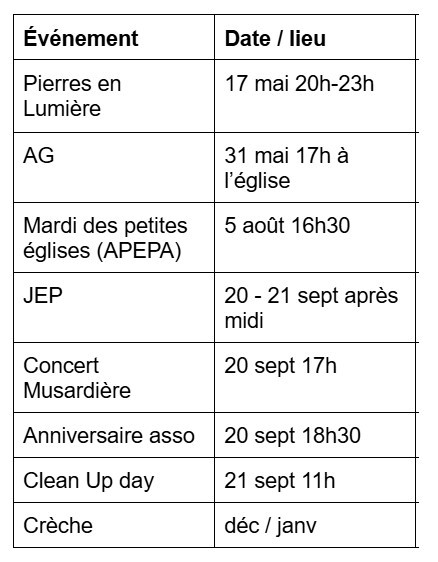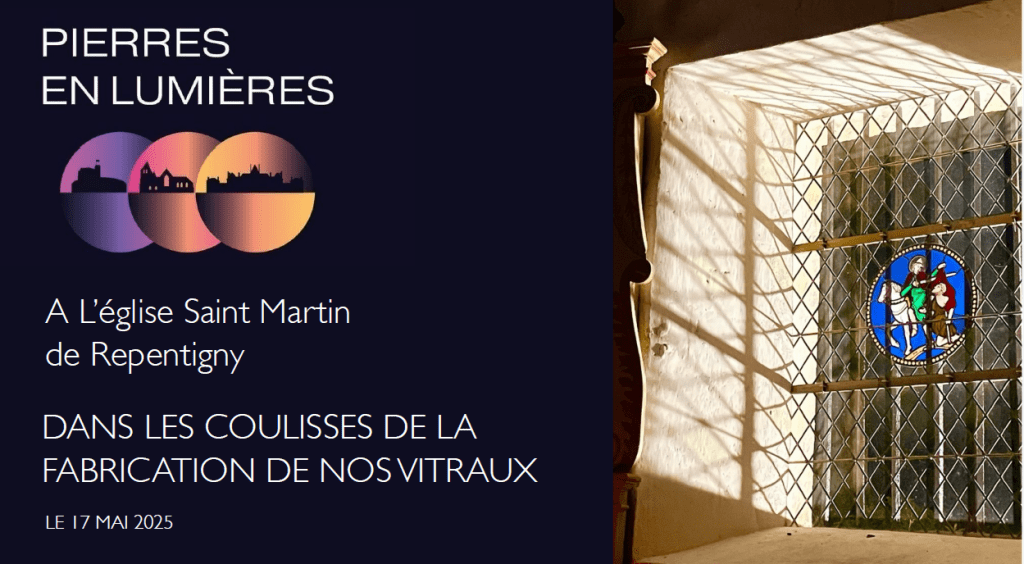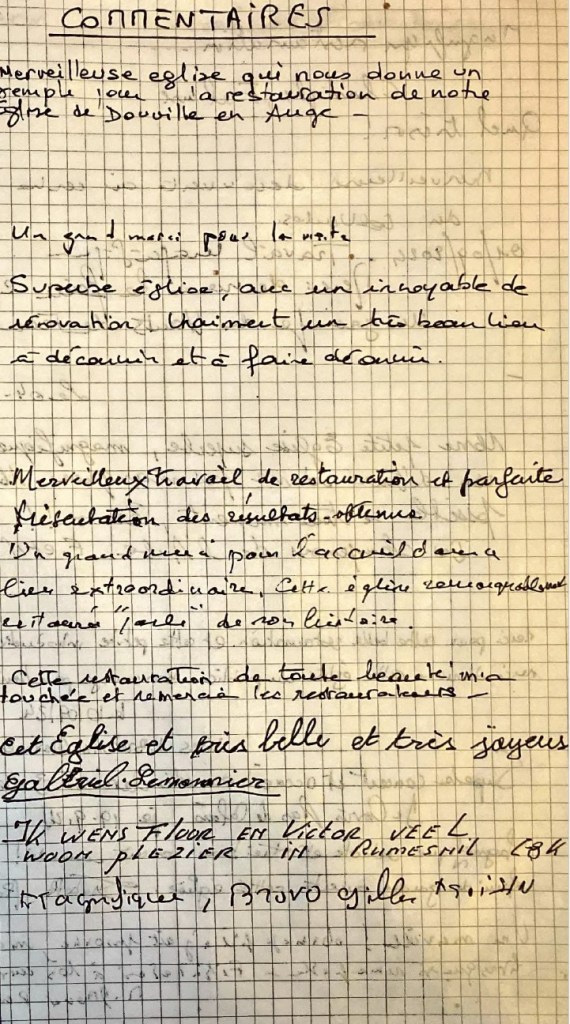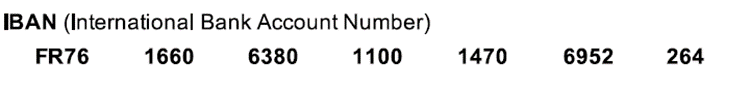Chers amis du patrimoine de Repentigny
Vous vous souvenez qu’en 2012 nous avions eu la surprise de découvrir, au dos des panneaux latéraux du retable, d’autres scènes religieuses.
Avant leur restauration, il fallait un œil d’aigle pour deviner ce dont il s’agissait.
Jugez plutôt leur état, après probablement plusieurs siècles d’oubli.
Grâce au talent et aux soins attentifs de notre restaurateur, M. Andronescu, elles ont repris vie et leur couleur grisaille d’origine.
Le même panneau en 2014 a meilleure allure :
Spectaculaire non !
Le panneau droit par exemple, après la restauration, est magnifique.
Reste une question qui nous taraude. Quel est cet évêque dont la vie nous est racontée ?
Notre église étant dédiée à Saint Martin, une hypothèse logique méritait d’être testée : cet évêque est-il le grand saint du 4ème siècle, évangélisateur de la Gaule, Saint Martin lui-même ?
En bons normands, nous serions tentés de dire : ptet ben qu’oui !
Différentes scènes font penser à sa vie telle que racontée par son disciple Sulpice Sévère.
Saint Martin est traditionnellement représenté, soit à cheval en soldat de l’armée romaine partageant son manteau avec un pauvre, soit en évêque (mitre, crosse) ce qui est le cas ici.
Saint Martin est né dans la Hongrie actuelle il y a 1700 ans, en 316 et il est mort en Gaule (Candes, situé entre Angers et Tours) 80 ans plus tard.
Il est fameux pour son évangélisation de la Gaule. Plus de 4000 églises portent son nom en France, dont plus de 110 dans le Calvados.
On le fête le 11 novembre, date choisie justement par les négociateurs français pour la signature de l’armistice de la guerre 1914-1918.
En partant du premier panneau en haut à gauche, notre enquête débute … et bute … sur un os !
Comment rattacher cette scène de chasse à la vie du saint homme ? Le lien est ténu mais il existe !
Dans l’iconographie de l’art chrétien de Louis Réaux, on apprend que saint Martin est aussi protecteur des animaux ! A Chartres, on voit aussi une statue de saint Martin sur le portail Sud : deux chiens poursuivent un lièvre ; saint Martin leur ordonne de lâcher leur proie.
Les martins pêcheurs lui doivent leur nom. Sulpice Sévère raconte, dans une de ses lettres à Bassula, sa belle-mère, cette anecdote.
Au soir de sa vie, Saint Martin entreprend son dernier voyage vers Candes.
« Parti, accompagné, suivant son usage, d’une troupe nombreuse de pieux disciples, il vit sur le fleuve des plongeons poursuivre des poissons, et exciter sans cesse leur gloutonnerie par de nouvelles captures : «Voici, dit-il, une image des démons, qui dressent des embûches aux imprudents, les surprennent et les dévorent, sans pouvoir se rassasier.» Alors Martin, avec toute la puissance de sa parole, commanda aux oiseaux de s’éloigner du fleuve et de se retirer dans des régions arides et désertes, employant contre eux le même pouvoir dont il usait souvent contre les démons. À l’instant tous ces oiseaux se rassemblent, et, quittant le fleuve, se dirigent vers les montagnes et les forêts, à la grande admiration de tous les spectateurs, qui voyaient Martin exercer son pouvoir, même sur les oiseaux. »
Après réflexions, c’est sans doute une scène introductive, imagée, où le cerf représente Jésus et la chasse, la quête spirituelle de Saint Martin. En effet, dans la tradition chrétienne médiévale, le cerf symbolise le Christ lui-même qui conduit les belles âmes vers les sommets de la sainteté.
Voir article en lien.Le deuxième panneau est sans équivoque. On y voit un évêque discutant avec un jeune homme. Les deux portent l’auréole des saints.
Sans doute Saint Hilaire, alors évêque de Poitiers, qui rencontre le jeune Martin après qu’il eut quitté le service de l’armée romaine.
Sulpice Sévère raconte : « Dans la suite, ayant quitté le service, Martin se rendit auprès de saint Hilaire, évêque de Poitiers ; homme dont la foi vive était connue et admirée de tout le monde ; il y resta quelque temps. Hilaire voulut le faire diacre pour se l’attacher plus étroitement et le consacrer au service des autels ; mais Martin avait souvent refusé, disant hautement qu’il en était indigne. Hilaire, dans sa sagesse, vit bien qu’il ne se l’attacherait qu’en lui conférant un emploi ; dans lequel il semblerait ne pas lui rendre justice ; il voulut donc qu’il fût exorciste. Martin ne refusa point cet ordre, de peur de paraître le mépriser, à cause de son infériorité. »
Le troisième panneau est encore plus explicite, on y voit une ordination épiscopale.
Martin, peu enclin aux honneurs, fut difficile à convaincre de prendre la mitre et la crosse. Sa nomination racontée par Sulpice Sévère fut apparemment mouvementée.
« C’est à peu près à cette époque que la ville de Tours demanda saint Martin pour évêque ; mais comme il n’était pas facile de le faire sortir de sa solitude, un des citoyens de la ville, nommé Ruricius, se jeta à ses pieds, et, prétextant la maladie de sa femme, le détermina à sortir. Un grand nombre d’habitants sont échelonnés sur la route ; ils se saisissent de Martin, et, le conduisent à Tours, sous bonne garde. Là, une multitude immense, venue non seulement de Tours mais des villes voisines, s’était réunie afin de donner son suffrage pour l’élection. L’unanimité des désirs, des sentiments et des votes, déclara Martin le plus digne de l’épiscopat, et l’Église de Tours heureuse de posséder un tel pasteur.
Un petit nombre cependant, et même quelques évêques convoqués pour élire le nouveau prélat, s’y opposaient, disant qu’un homme d’un extérieur si négligé, de si mauvaise mine, la tête rasée et si mal vêtu, était indigne de l’épiscopat. Mais le peuple, ayant des sentiments plus sages, tourna en ridicule la folie de ceux qui, en voulant nuire à cet homme illustre, ne faisaient qu’exalter ses vertus.
Les évêques furent donc obligés de se rendre au désir du peuple, dont Dieu se servait pour faire exécuter ses desseins. »
Le quatrième tableau est lui aussi clair. On y voit notre saint évêque aux prises avec un esprit malin, un spectre, un démon.
La vie de Saint Martin abonde d’exemples de ce type. Par exemple au Chapitre XVII :
« À la même époque, Tétradius, personnage consulaire, avait un esclave possédé du démon, et qui allait faire une fin déplorable. On pria Martin de lui imposer les mains, et il se le fit amener. Mais on ne put faire sortir le possédé de la cellule, car il mordait cruellement ceux qui s’en approchaient. Alors Tétradius, se jetant aux pieds de Martin, le supplia de venir lui-même dans la maison où se trouvait le démoniaque ; mais il refusa, disant qu’il ne pouvait entrer dans la demeure d’un profane, et d’un païen. Tétradius était encore plongé dans les erreurs du paganisme ; mais il promit de se faire chrétien, si son serviteur était délivré du démon. C’est pourquoi Martin imposa les mains à l’esclave, et en chassa l’esprit immonde. À cette vue, Tétradius crut en Jésus-Christ. Il fut aussitôt fait catéchumène, baptisé peu de temps après, et depuis lors il eut toujours un respect affectueux pour Martin, l’auteur de son salut.
Vers la même époque et dans la même ville, Martin, étant entré dans la maison d’un père de famille, s’arrêta sur le seuil, disant qu’il voyait un affreux démon dans le vestibule. Au moment où Martin lui commandait de sortir, il s’empara d’un esclave qui se trouvait dans l’intérieur de la maison ; ce malheureux se mit aussitôt à mordre et à déchirer tous ceux qui se présentaient à lui. Toute la maison est dans le trouble et l’effroi ; le peuple prend la fuite. Martin s’avance vers le furieux, et lui commande d’abord de s’arrêter ; mais il grinçait des dents, et, ouvrant la bouche, menaçait de le mordre ; Martin y met ses doigts : « Dévore-les, si tu en as le pouvoir, » lui dit-il. Alors le possédé, comme si on lui eut plongé un fer rouge dans la gorge, recula pour éviter de toucher les doigts du Saint. Enfin le diable, forcé par les souffrances et les tourments qu’il endurait de quitter le corps de l’esclave, et ne pouvant sortir par sa bouche, s’échappa par les voies inférieures, en laissant des traces dégoûtantes de son passage. »Sic !
Dans le cinquième panneau, on voit l’évêque endormi sous la protection de Dieu dans une maison en flammes. Ceci est clairement rattachable à la vie de Saint Martin dans un épisode relaté par Sulpice Sévère dans sa « Lettre au père Eusèbe ».
« Un jour d’hiver, Martin visitant une paroisse (suivant l’habitude des évêques), les clercs lui préparèrent un logement dans la sacristie, allumèrent un grand feu dans une sorte de fourneau très mince et construit en pierres brutes, puis lui dressèrent un lit, en entassant une grande quantité de paille. Martin s’étant couché eut horreur de la délicatesse de ce lit, à laquelle il n’était pas habitué, car il avait coutume de coucher sur un cilice, étendu sur la terre nue.
Mécontent de ce qu’il regardait comme une injure, il repoussa la paille, qui s’accumula par hasard sur le fourneau ; puis, fatigué du voyage, il s’endormit, étendu par terre, suivant son usage. Vers le milieu de la nuit, le feu, étant très ardent, se communiqua à la paille à travers les fentes du fourneau. Martin, réveillé en sursaut, surpris par ce danger subit et imminent, et surtout, comme il le raconta lui-même, par l’instigation du démon, eut recours trop tard à la prière ; car, voulant se précipiter au dehors, et ayant fait de longs efforts pour enlever la barre qui fermait la porte, un feu si violent l’environna, que le vêtement qu’il portait fut consumé.
Enfin, rentrant en lui-même, et comprenant que ce n’était pas dans la fuite, mais dans le Seigneur qu’il trouverait du secours, il s’arma du bouclier de la foi et de la prière, et, se remettant tout entier entre les mains de Dieu, il se précipita au milieu des flammes. Alors le feu s’étant éloigné miraculeusement de Martin, celui-ci se mit en prière au milieu d’un cercle de flammes dont il ne ressentait nullement les atteintes. Les moines qui étaient au dehors, entendant le bruit et les pétillements de la flamme, enfoncent les portes, écartent les flammes, et en retirent Martin, qu’ils croyaient déjà entièrement consumé. Du reste, Dieu m’en est témoin, Martin lui-même me racontait et avouait en gémissant, que c’était par un artifice diabolique, qu’à l’instant de son réveil il n’avait pas eu la pensée de repousser le danger par la foi et la prière ; qu’enfin il avait senti l’ardeur des flammes jusqu’au moment où, rempli de frayeur, il s’était précipité vers la porte ; mais qu’aussitôt qu’il avait eu recours au signe de la croix et aux armes puissantes de la prière, les flammes s’étaient retirées, et qu’après lui avoir fait sentir leurs cruelles atteintes, elles s’étaient ensuite transformées en une douce rosée. Que celui qui lira ces lignes comprenne que si ce danger a été pour Martin une tentation, il a été aussi une épreuve de Dieu. »
Le sixième, et dernier panneau de cette partie droite, est étonnant. Regardez bien ce qui sort de la bouche de la jeune femme agenouillée !
Un espèce de démon noir.
Scène d’exorcisme ou miracle de la jeune fille muette à qui Saint Martin avait rendu la parole.
Sulpice Sévère raconte dans son troisième dialogue:
« Et d’abord, je désire vivement vous raconter un miracle que Réfrigérius me souffle à l’oreille ; il s’est passé dans la ville de Chartres. Un père de famille présenta à Martin sa fille, âgée de douze ans et muette de naissance, suppliant le Saint de lui rendre l’usage de la langue par ses mérites. Martin, par déférence pour les évêques Valentinien et Victrice, qui se trouvaient par hasard près de lui, disait que cette tâche était au-dessus de ses forces, mais, qu’elle n’était pas impossible à ces saints évêques. Ceux-ci joignirent leurs pieuses instances aux supplications du père, et le prièrent d’acquiescer à sa demande. Le saint homme n’hésita pas (quelle humilité et quelle admirable miséricorde !) et fit éloigner le peuple. En présence seulement des évêques et du père de la jeune fille, il se mit en prière, selon son habitude il bénit ensuite un peu d’huile, en récitant une formule d’exorcisme, et versa la liqueur sacrée sur la langue de la jeune fille, qu’il tenait entre ses doigts. Son attente ne fut point trompée. Il lui demanda le nom de son père, qu’elle prononça aussitôt ; celui-ci jette un cri, se précipite aux pieds de Martin, en pleurant de joie, et assure aux assistants étonnés que c’est la première parole qu’il entend prononcer à sa fille. Si par hasard ce fait vous parait incroyable, Évagrius, ici présent, vous attestera sa véracité, car il en fut témoin. »
Crédit photos : Philippe Duflot (MOF) et Gilbert Guillotin – Photo Club de Cambremer